
Crédit photo: Jo-Anne McArthur / Essere Animali / We Animals Media
La philanthropie animaliste est-elle un antihumanisme ?
Les gestes altruistes à destination des animaux sont en forte hausse, à tel point qu’on pourrait aujourd’hui qualifier de mainstream cette tendance philanthropique. Dans un récent sondage de l’Institut Mallet sur les dons des Québécois·e·s en contexte de pandémie, on apprenait que ce sont maintenant 18% des donneurs et donatrices qui appuient « la défense des animaux ».
Cela en fait la quatrième cause la plus populaire, celle-ci prenant les devants sur les dons consacrés aux « personnes âgées ». Si nos amis à poil et à plume peuvent se réjouir de ces données, en va-t-il ainsi pour nos confrères et consœurs humains ? Un surplus de solidarité et de bienveillance à l’égard des animaux se traduit-il par une baisse générale de la solidarité et de la bienveillance disponibles pour les humains ? Et par-delà ces considérations sur une administration plus optimale de nos bons sentiments comme société, l’idée même de générosité envers les animaux ne correspondrait-elle pas à un travestissement de la philanthropie, elle dont l’étymologie signifie littéralement « l’amour de l’humain » ? La philanthropie peut-elle, ontologiquement parlant, inclure les animaux sans pour autant être en contradiction avec elle-même, sans provoquer une distorsion de son sens premier ?
À la suite du pape François 1er, lequel s’inquiète de la hausse des couples choisissant d’adopter des animaux au lieu d’avoir des enfants, il semble légitime et même éthiquement nécessaire de se demander si les ressources charitables octroyées à la cause animale équivalent à priver des humains, et a fortiori des humains dans le besoin, de ressources qui auraient pu améliorer leurs conditions d’existence. En suivant une telle logique, il ne semble pas infondé de prétendre que le dévouement pour les animaux, par-delà un certain seuil, constitue une perversion de la moralité, un acte de négligence et d’indifférence envers le sort de concitoyens et concitoyennes. C’est du moins une thèse que défend l’anthropologue français Jean-Pierre Digard (2018). Ce dernier considère que l’animalisme peut représenter une pente glissante vers l’antihumanisme.
Bref, pour le dire autrement : qu’ont de philanthropique – au sens d’humainement souhaitable – les dons dédiés à la cause animale ? C’est sur cette question philosophique que se penche notre billet. Dans le but de dénouer l’opposition entre l’intérêt général des humains et celui des animaux, nous reviendrons sur certaines idées présentes dans la littérature et sur les pages web d’organisations dédiées au bien-être animal. Une recension rapide d’informations nous permettra, dans un premier temps, de dégager trois arguments combinant « progrès de la condition animale » à « progrès de la condition humaine ». Chacun à leur façon, ces arguments s’opposent donc à la thèse voulant que la défense des animaux soit incompatible avec le progrès de l’espèce humaine. Une fois cela établi, nous inviterons les fondations à s’ouvrir à cette cause et terminerons notre réflexion en proposant quelques pistes concrètes d’action pour elles.
L’argument utilitariste
On observe une diminution des hormones liées au stress, comme le cortisol, après une interaction avec un animal. Les interactions peuvent aussi naturellement faire augmenter le taux d’hormones liées au bonheur, comme la sérotonine et la dopamine.
— Hanit Isakovan, psychothérapeute[1]

Source: Fondation Mira
Selon le point de vue utilitaire, il est dans l’intérêt des humains de veiller au bien-être des animaux. Nous y voyons un argument qui se préoccupe plus du bienfait de la présence animale sur les humains que de voir s’installer une relation respectueuse avec des animaux.
Cela est particulièrement évident dans le cas des animaux de compagnie, où un nombre croissant d’études mesurent les bienfaits que procure l’interaction avec cette catégorie animale au quotidien. Avoir un chien, un chat, un oiseau, des poissons à la maison contribuerait à réduire l’anxiété, à briser l’isolement (notamment chez les personnes âgées), à renforcer l’estime de soi chez les adolescent·e·s, à faciliter le développement social de l’enfant… Cela s’est révélé parfaitement le cas depuis le début de la pandémie. Le nombre de chiens et de chats dans les foyers a connu une forte croissance (plus de 200 000 seulement au Québec[2]).
Sur cette lancée, une mention spéciale doit être faite aux organisations spécialisées dans le domaine de la zoothérapie. Les services d’intervention assistée avec animaux de compagnie qu’offrent ces organisations représentent une mise à profit encore plus réfléchie et ciblée des vertus thérapeutiques que confèrent les animaux. Comme l’explique l’organisation Zoothérapie Québec, véritable pionnière dans la province : « [nous mettons à profit et misons] sur la réciprocité dont fait preuve l’animal de compagnie et sur son potentiel de stimulation et de motivation. Il développe ainsi des services d’intervention et de prévention qui utilisent ces qualités »[3].
Une logique similaire est à l’œuvre avec les services d’accompagnement rendus par des chiens formés auprès d’individus atteints d’un handicap ou d’un trouble : pensons aux chiens Mira par exemple. Là encore il est question d’être en rapport avec des animaux qui prennent soin de personnes ou de familles en retour.
Toujours dans la perspective utilitariste, il est aussi possible de pousser le raisonnement en s’intéressant aux nuisances associables à l’élevage industriel d’animaux pour la consommation. En effet, l’hégémonie du carnisme, lequel se traduit par une consommation excessive de viande, engendre des impacts négatifs non négligeables sur les humains. Réduire notre dépendance à la viande procurerait des avantages certains.
- Cela permettrait de prévenir les souffrances psychologiques que développent un grand nombre d’ouvriers·ières travaillant dans les abattoirs[4].
- Cela diminuerait la consommation de viande rouge et de charcuteries, laquelle augmente les risques de développer une maladie cardiovasculaire[5] ou un cancer colorectal[6].
- Enfin, sur le plan environnemental, l’élevage intensif est incompatible avec la lutte au dérèglement climatique et l’atteinte de la carboneutralité. À l’heure actuelle, l’industrie de la viande produit à elle seule autant de GES que tous les modes de transport réunis[7]. Privilégier le végétarisme ou le végétalisme aiderait à contenir la crise climatique.
Pour résumer, même en faisant fi de toutes les souffrances que subissent les quelques 65 milliards d’animaux tués chaque année, cesser de les manger et de les exploiter à grande échelle serait un moyen efficace pour améliorer les conditions de vie des humains. Comme quoi il y a nul besoin d’être réellement empathique au sort des animaux pour défendre une amélioration de leur condition d’existence.
L’argument moral
La grandeur d’une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités.
— Gandhi

Source: Animal Action Everywhere
Un deuxième ensemble d’arguments avance l’idée que la défense de la cause animale représente un perfectionnement moral de l’individu et de la société. S’ancrant davantage dans une éthique de la conviction que de la responsabilité (Weber, 1959), ces arguments plaident que notre sollicitude envers les animaux est à rechercher en soi et non nécessairement pour les bénéfices directs qu’il est possible d’en tirer, comme cela était le cas avec l’argumentaire utilitariste.
Le point de départ de cette posture éthique prend généralement racine dans les faits scientifiques reconnaissant la sentience, c’est-à-dire la capacité qu’auraient les animaux d’éprouver des choses subjectivement et, par le fait même, de ressentir du plaisir, de la douleur et des émotions[8]. Cet acte de reconnaissance invite à faire preuve d’une plus grande réflexivité sur l’impact des activités humaines et à développer une distanciation critique vis-à-vis les souffrances inutiles – et donc injustifiées – qu’elles infligent aux animaux. Ainsi, parce qu’elle force la réflexion philosophico-éthique à sortir d’un cadre anthropocentriste et à s’interroger sur nos responsabilités à l’égard d’autres espèces – à commencer par les vertébrés munis d’un système nerveux central – cette prise en compte de la sentience opère ce que le philosophe Peter Singer (2012) appelle un « élargissement du cercle de la moralité ».
C’est d’ailleurs à cet argument moral que se montre particulièrement sensible l’interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), statuant sur le caractère bienfaisant des organismes qui opèrent pour le bien-être animal. En effet, cette interprétation s’y réfère pour reconnaître le droit des défenseurs de la cause animale à l’obtention d’un numéro de charité et aux avantages fiscaux correspondants. Afin d’être reconnue comme cause de bienfaisance, la protection des animaux doit contribuer à « promouvoir le développement moral ou éthique de la collectivité »[9]. Lorsqu’il est possible de le démontrer, alors le statut d’organisme de bienfaisance peut être accordé.
En repoussant les frontières des êtres vivants jugés dignes de nos considérations morales, il est possible de réformer les politiques publiques responsables de garantir le bien-être et la sécurité des animaux. Au Québec, plusieurs organisations à but non lucratif associées au mouvement végane luttent pour une meilleure reconnaissance des animaux en tant que sujets de droit. C’est le cas, par exemple, de l’organisme Droit animalier Québec : « un regroupement de professionnels, d’experts et de membres de la communauté québécoise ayant un intérêt particulier pour le droit animalier et l’éthique animale au Québec »[10]. Leurs interventions juridiques se concentrent notamment sur l’application de la Loi sur le bien-être et la sécurité animale (communément appelée Loi BÊSA). On peut aussi penser à l’ONG Sea Sheperd, laquelle mène des actions directes – notamment des missions d’abordage en pleine mer – afin de saboter des activités illégales liées, entre autres, à la surpêche et à la pêche de cétacés. Bref, en revendiquant un meilleur encadrement légal des activités humaines liées à la prédation et à l’exploitation des animaux (braconnage, cruauté animale, élevage intensif, pratiques d’abattage, etc.), ce type d’organisations contribuent à renforcer et à élargir le périmètre d’action de notre société de droit.
L’argument politique
La conception selon laquelle l’humanité doit dominer et exploiter la nature découle de la domination et de l’exploitation de l’homme par l’homme, et même, plus loin encore dans le temps, de l’assujettissement de la femme à l’homme au sein de la famille patriarcale.
— Murray Bookchin, théoricien de l’écologie sociale[11]

Source: PETA India
Une troisième catégorie d’arguments consiste à revendiquer, dans un même mouvement, et la libération animale et l’émancipation des humains vis-à-vis toutes formes d’oppression. Ces deux luttes étant dites indissociables l’une de l’autre. Généralement avancés par des acteurs associés à la gauche radicale, et plus particulièrement à la mouvance anti-spéciste, ces arguments se démarquent de par leur caractère critique. Ils dénoncent les accointances idéologiques qu’entretient notre système d’exploitation animale avec d’autres systèmes de domination de l’humain par l’humain (sexisme, racisme, classisme, capacitisme, etc.). Promouvoir l’égalité inter-espèce constituerait un moyen politique pour plus de justice sociale et animale dans nos sociétés. C’est la ligne de pensée qu’emprunte l’association française L214 lorsqu’elle établit une correspondance entre les modes de légitimation à l’œuvre dans le spécisme et le racisme.
L’espèce ne nous dit pas plus que la « race » quelle importance accorder aux intérêts d’un individu. Dire simplement qu’un être n’est pas humain ne nous apprend rien sur ce qu’il est, sur ce qu’il vit, et sur l’importance que l’on doit accorder à ses intérêts. Vouloir conditionner la manière dont on traite un individu à son appartenance au même groupe biologique que nous est spéciste, de la même manière que privilégier les membres de sa supposée « race » est raciste.[12]
Cette intersectionnalité entre formes d’oppression animale et formes d’oppression humaine n’a pas qu’une portée symbolique. Elle se traduit concrètement en actions collectives. Le mouvement antivivisectionniste qui a pris racine en France au 19e siècle illustre bien l’entrelacement de revendications féministes et animalistes. Majoritairement investi par des femmes, ce mouvement dénonçait l’influence intellectuelle et politique « d’hommes de science » qui contrôlaient les instances de la SPA et qui présentaient comme légitimes les expériences scientifiques sur les animaux (Carrié, 2018). Pour les militantes s’opposant à ce genre de pratiques, la cause animale est devenue une opportunité d’occuper davantage l’espace public et de contester le monopole masculin sur la définition du bien-être animal (Idem.).
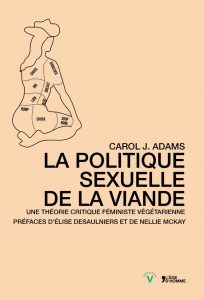 Dans la même optique, mais plus près de nous, soulignons l’exemple des éco-féministes qui s’en prennent à la culture de la consommation de viande, l’accusant d’alimenter les expressions toxiques de la masculinité. Dans son livre La politique sexuelle de la viande : une théorie critique féministe végétarienne, Carol J. Adams conçoit le végétarisme non seulement comme un régime alimentaire exempt de cruauté animale, mais, plus fondamentalement, comme une posture féministe critiquant l’origine patriarcale des violences commises à l’endroit des autres espèces. « À travers le symbolisme basé sur la mise à mort des animaux, explique-t-elle, nous rencontrons des images politiquement chargées des thèmes de l’appropriation, du contrôle, de la domination et de la violence. Ce message de dominance masculine est véhiculé par la consommation de viande, tant au niveau symbolique que dans la réalité » (ma traduction, Adams, 1990, p.189).
Dans la même optique, mais plus près de nous, soulignons l’exemple des éco-féministes qui s’en prennent à la culture de la consommation de viande, l’accusant d’alimenter les expressions toxiques de la masculinité. Dans son livre La politique sexuelle de la viande : une théorie critique féministe végétarienne, Carol J. Adams conçoit le végétarisme non seulement comme un régime alimentaire exempt de cruauté animale, mais, plus fondamentalement, comme une posture féministe critiquant l’origine patriarcale des violences commises à l’endroit des autres espèces. « À travers le symbolisme basé sur la mise à mort des animaux, explique-t-elle, nous rencontrons des images politiquement chargées des thèmes de l’appropriation, du contrôle, de la domination et de la violence. Ce message de dominance masculine est véhiculé par la consommation de viande, tant au niveau symbolique que dans la réalité » (ma traduction, Adams, 1990, p.189).
Enfin, au-delà d’être une nouvelle pièce venant complexifier l’interconnectivité des systèmes d’oppression, ajoutons que l’anti-spécisme peut même verser dans l’anticapitalisme. En effet, le problème de la propriété privée et de la marchandisation du vivant qui en découle constitue un frein notable à l’avancement du droit animal. Les philosophes Christiane Bailey et Jean-François Labonté nous rappellent à juste titre que des contradictions fondamentales opposent la protection des intérêts des animaux d’un côté et la légalisation de leur commercialisation de l’autre côté.
Si nous voulons être conséquents et aboutir à un réel changement social, la reconnaissance de la sensibilité des animaux devrait nous conduire à abandonner le régime de propriété. Accorder un statut juridique de « bien sensibles » ne change rien au fait que les animaux sont encore des choses devant la loi – des marchandises que nous pouvons acheter, vendre, exploiter et tuer pour un tirer profit – et non des sujets de droits. (Bailey et Labonté, 2018, p. 17)
L’anti-spécisme a une portée révolutionnaire, au sens où il résiste et s’oppose au principe de la marchandisation : un mécanisme constitutif du mode de production capitaliste. C’est pourquoi les luttes de libération des animaux peuvent trouver écho auprès des thématiques socialistes visant l’émancipation des salarié·e·se·ss.
La cause animale mériterait plus d’attention de la part des fondations et des mécènes
À la lumière des trois types d’arguments que nous avons esquissés, revenons à notre interrogation de départ. Est-ce philanthropiquement justifié d’appuyer la cause animale ?
Dans les faits, une philanthropie dirigée vers les animaux ne se désintéresserait pas du devenir de l’humain. Au contraire ! Même si elle ne lui rapportait guère de bénéfices directs (argument utilitariste) ou qu’elle ne l’aidait pas à produire une société moins aliénante (argument politique), cette philanthropie permettrait néanmoins d’élever la grandeur d’âme humaine et de redéfinir l’étendue de nos responsabilités à l’égard du monde qui nous entoure (argument moral).
Dans un contexte de crise environnementale et d’effondrement de la biodiversité liée à une surexploitation de la nature, apprendre à faire preuve de générosité et d’empathie envers les habitants non-humains de la planète ne pourra que nourrir la réalité écosystémique d’interdépendance qui nous lie aux autres espèces. C’est à cette condition que l’humain concrétisera son ré-encastrement dans la nature. La sortie de crise passera impérativement par le renversement du « suprémacisme humain » (Bonnardel et Playoust-Braure, 2020). Une posture trop longtemps légitimée par des idées philosophiques réduisant l’humain à un sujet rationnel extérieur à la nature et pouvant la traiter à bon aloi comme son objet. La philanthropie animale peut contribuer à poser les bases d’un ordre social où la cohabitation inter-espèce ne se fait plus sur le mode de la domination, mais sur celui de la bienveillance et du respect.
Ceci dit, ma collègue Katherine MacDonald rappelle[13], à juste titre, que les financements des fondations subventionnaires canadiennes à l’intention du bien-être animal sont minimes, voire quasi inexistants, ce qui contraste avec les particuliers qui financent substantiellement cette cause. Cette absence des donateurs institutionnels prend tous les aspects d’une négligence alors que nous venons de voir en quoi le bon entendement rend légitime le fait de s’y engager.
Pistes d’action potentielles
Que pourraient faire les fondations pour combler ce retard ? Plusieurs choses en fait. Nous nous contenterons d’indiquer quelques pistes, question d’ouvrir la réflexion.
Une première piste consisterait à s’interroger sur la manière dont la prise en compte des animaux affecte la mission des fondations. Par exemple, des fondations qui opèrent dans le domaine de la santé mentale, du développement des enfants ou encore dans le soutien aux aînées pourraient miser sur les bienfaits que génère l’interaction avec des animaux pour des résultats prometteurs. D’un autre côté, les fondations qui travaillent dans le domaine du développement durable, de la sécurité alimentaire et du développement de systèmes alimentaires durables ne peuvent faire fi des dommages environnementaux et sociaux qu’occasionne la production industrielle de produits animaliers.
Une autre piste consisterait à s’interroger sur l’impact des activités d’organisations philanthropiques sur les animaux. Quelle est la somme des cruautés animales présentes dans la nourriture offerte lors des événements-bénéfices et autres activités organisées par de telles organisations ? Il est même possible d’aller plus loin en s’intéressant aux impacts du fonds de dotation sur le bien-être animal. Est-ce que les investissements d’une fondation supportent des entreprises agroalimentaires, lesquelles sont au cœur de pratiques d’élevage intensif ?[14] Les gestionnaires de portefeuille peuvent-ils présenter des données extra-financières sur l’impact des entreprises au niveau de la faune et de la flore, et plus particulièrement sur les espèces menacées et en voie de disparition?
Une troisième voie à considérer est de se demander si les fondations contribuent positivement à l’élévation du débat public et à la conscientisation autour de cet enjeu. Par exemple, les fondations qui ont récemment adhéré à l’Engagement de la philanthropie canadienne sur le dérèglement climatique s’intéressent-elles aussi aux grandes quantités de GES qu’engendre l’industrie de la viande ? Et puisqu’elles se sont engagées à reconnaître la gérance autochtone en matière de gestion du territoire, pourraient-elles contribuer à la valorisation des savoirs autochtones en ce qui a trait à l’équilibre des écosystèmes et aux espèces qui y habitent ?[15] Approcher de cette façon la cause animale représenterait une manière appropriée de promouvoir un animalisme qui va de pair avec d’autres engagements sociaux en matière de réconciliation et de décolonisation.
Cet article fait partie de l’édition spéciale de Janvier 2022 : Philanthropie et la cause animale. Vous pouvez trouver plus d’informations ici

Références
Adams, C. J. (1990). The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory, New York, Continuum.
Bailey, C. & Labonté J.-F. (2018). La philosophie à l’abattoir. Réflexions sur le bacon, l’empathie et l’éthique animale, Montréal, Atelier 10.
Bonnardel, Y. & Playoust-Braure, A. (2020). « 4. La viande, symbole du suprémacisme humain ». Dans : A. Playoust-Braure & Y. Bonnardel (Dir), Solidarité animale : Défaire la société spéciste (pp. 85-105), Paris, La Découverte.
Bookchin, M. (2019). Pourvoir de détruire. Pouvoir de créer. Vers une écologie sociale et libertaire, Paris, Éditions l’Échappée.
Carrié, F. (2018). « « Vraies protectrices » et représentantes privilégiées des sans-voix : l’engagement des femmes dans la cause animale française à la fin du XIXe siècle », Open Edition Journals [en ligne], lien URL : https://journals.openedition.org/genrehistoire/4102
Digard, J.-P. (2018). L’animalisme est un anti-humanisme, Paris, CNRS Éditions.
Singer, P. (2012). La libération animale, Paris, Éditions Payot.
Weber, M. (1959). Le savant et le politique, Paris, Librairie Plon.
[1] https://luminosante.sunlife.ca/s/article/Les-bienfaits-des-animaux-de-compagnie-sur-la-sante-mentale?language=fr
[2] https://www.amvq.quebec/fr/nouvelles/resultats-sondage—ladoption-de-chats-et-de-chiens-au-quebec-lors-de-la-pandemie-de-la-covid-19
[3] https://zootherapiequebec.ca/
[4] Dans son documentaire « Les Damnés, des ouvriers en abattoir », Anne-Sophie Reinhardt recueille les témoignages de travailleurs et de travailleuses qui racontent leur expérience dans cette industrie et s’ouvrent sur les séquelles qu’ils et elles ont conservés. Voir : https://lesbatelieresproductions.com/films/l-arbre-qui-cachait-la-foret
[5] https://www.sciencesetavenir.fr/sante/maladies-cardiovasculaires-viande-rouge-et-transformee-toujours-mises-en-cause_153569
[6] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/746257/oms-viande-cancer-colorectal-circ
[7] https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/11/pourquoi-la-viande-est-elle-si-nocive-pour-la-planete_5395914_4355770.html
[8] https://theconversation.com/heres-what-the-science-says-about-animal-sentience-88047
[9] https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/promotion-protection-animaux-enregistrement-a-titre-organisme-bienfaisance.html#toc5
[10] https://daq.quebec/a-propos/
[11] Murray Bookchin (2019). Pourvoir de détruire. Pouvoir de créer. Vers une écologie sociale et libertaire, Paris, Éditions l’Échappée, p. 28.
[12] https://www.l214.com/antispecisme
[13] https://philab.wpdev0.koumbit.net/blogue-accueil/animal-shelter-philanthropy/
[14] Dans les dernières années, sont même apparus des fonds d’investissement dont la mission est de favoriser la croissance de l’industrie végane. Voir : https://vegemontreal.org/nouvelle/vivre-vege/consommation/vegan-capital-une-solution-financiere-pour-investir-et-soutenir-lindustrie-vegane/16345/
[15] Pour découvrir un cas d’engagement philanthropique et communautaire de réhabilitation des animaux de la faune qui travaille en collaboration avec les organisations autochtones locales, voir : https://philab.wpdev0.koumbit.net/blogue-accueil/towards-reconciliation-philanthropy-animal-human-relationships-and-community-engaged-learning/

